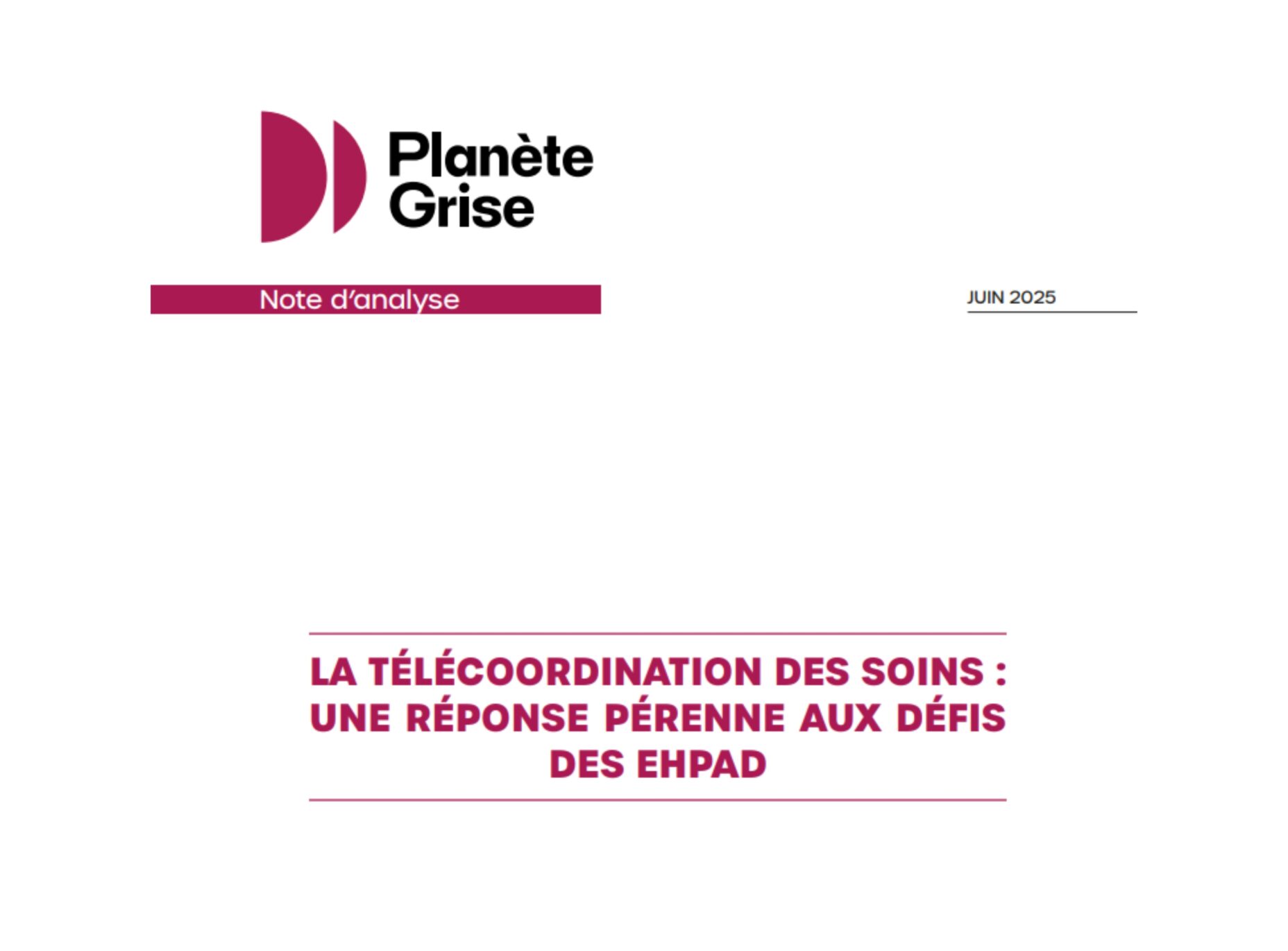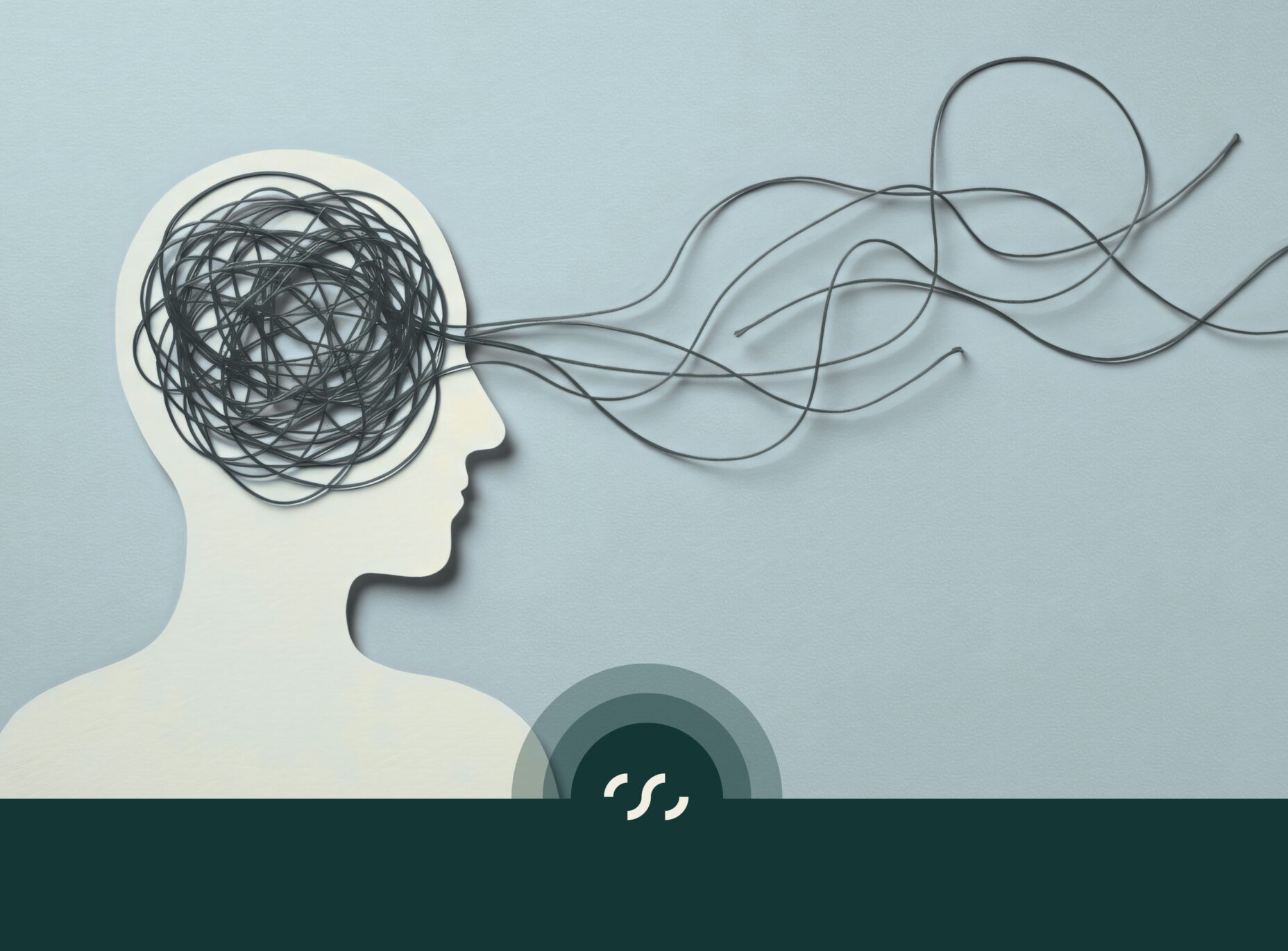En 2025, la question de la coordination des soins en EHPAD s’impose comme un enjeu central. Face au vieillissement de la population, à la complexité croissante des prises en charge et à la pénurie de professionnels de santé, la fluidité des échanges entre médecins, soignants et établissements conditionne directement la qualité des soins et la vie des résidents.
QUAND LA COORDINATION DES SOINS EN EHPAD FAIT DÉFAUT : DES CONSÉQUENCES CONCRÈTES
La coordination des soins n’est pas une simple question d’organisation administrative : elle a un impact direct sur la santé des personnes âgées dépendantes. Voici quelques exemples vécus sur le terrain :
- Retards de prise en charge : un résultat d’examen médical qui tarde à être transmis ou à être pris en compte peut retarder l’adaptation d’un traitement ou une hospitalisation, avec des conséquences graves sur l’état de santé du résident.
- Ruptures de suivi : en cas de changement de médecin traitant ou de départ d’un professionnel, l’absence de transmission structurée peut entraîner une perte d’informations médicales essentielles.
- Hospitalisations évitables : faute d’un suivi coordonné, l’état de santé d’un résident se dégrade, entraînant une hospitalisation en urgence alors qu’une intervention médicale précoce aurait permis d’éviter cette hospitalisation.
- Charge accrue pour les équipes : les infirmiers et soignants passent un temps précieux à courir après des informations médicales, au détriment du temps consacré aux résidents.
Ces quelques situations fréquentes illustrent combien la coordination est essentielle pour prévenir les ruptures de parcours et éviter des complications évitables.
UN CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE EN ÉVOLUTION
Le Décret n°2025-897 du 4 septembre 2025 est venu renforcer le cadre de l’organisation des soins en EHPAD. Il redéfinit les missions des médecins coordonnateurs et officialise le rôle des infirmiers coordonnateurs. Surtout, ce décret officialise le recours à la télécoordination lorsqu’une présence d’un médecin coordonnateur sur site n’est pas possible. Cette avancée institutionnelle consacre une pratique déjà expérimentée avec succès sur le terrain.
LA TÉLÉCOORDINATION : UNE RÉPONSE CONCRÈTE
La télécoordination ne se limite pas à un simple échange à distance : c’est un outil puissant pour fluidifier l’organisation des soins.
Concrètement, elle permet :
• à un médecin coordonnateur d’organiser des réunions de soins (« staffs »), de valider un projet thérapeutique ou de faire des recommandations médicales, même sans être physiquement présent ;
• aux équipes soignantes de disposer d’un accès rapide et structuré à la compétence et à l’expertise d’un médecin ;
• aux familles de bénéficier d’une meilleure continuité dans le suivi de leur proche, avec moins de ruptures et plus de réactivité.
LE RÔLE PIONNIER DE KOORD
Depuis plusieurs années, Koord a fait de la télécoordination sa mission. En centralisant les informations médicales, en facilitant les échanges sécurisés entre professionnels et en permettant au médecin coordonnateur d’intervenir à distance, Koord contribue à éviter les retards, les doublons et les hospitalisations inutiles.
En 2025, après avoir été pionnière, cette approche devient une réponse structurante aux défis des EHPAD, avec un décret venant confirmer la pertinence de ce modèle.
CONCLUSION
La coordination des soins est un enjeu majeur car elle conditionne la qualité, la sécurité et la continuité de la prise en charge en EHPAD. Face aux difficultés rencontrées au quotidien, la télécoordination apparaît comme une solution concrète et efficace. Avec son rôle pionnier, Koord participe activement à ce changement, en rendant la coordination plus fluide, plus réactive et plus humaine.
SOURCES
- Décret n° 2025-897 du 4 septembre 2025 relatif aux missions et conditions d’exercice des infirmiers et médecins coordonnateurs en EHPAD, Journal officiel de la République française, 6 septembre 2025 | Legifrance